Certains,
déjà, pensent à l’après et fixent leurs yeux dans le ciel, avec une pointe de
regret : « on est pas près de revoir un ciel d’une telle tenue », me disait un homme qui s'était échappé de Paris, juste avant la fin du confinement total. Sur le chemin
d’une autorisation dérogatoire, en bord de route nationale, la succession des
arrêts lui avait permis cette précieuse contemplation : « j’ai regardé les
changements de teintes, j’ai admiré les nuages, à ce niveau-là, entre ciel et
cieux », où on sent passer l’humilité, aurait-il pu ajouter, en paraphrasant
Jacques Brel. Un ciel à la Poussin, d’abord, bleu sidéral avec des nuages
blancs, toujours à la perfection comme il n’en existe quasiment jamais. Ou
alors un ciel à la Turner où c’est la couleur, dans un tourbillon spectral, qui
l’emporte sur le tout : tout est jaune, ocre, relevé de zébrures d’orange et on
s’y perd dedans comme certaines locomotives qui émergent des tableaux du
peintre anglais. Les locomotives, symbole par excellence du modernisme, de l’ère
industrielle : tout cela poussé à son apogée, avec de la pollution et des
guirlandes blanches de kérosène, et voici qu’un confinement planétaire nous
assure une contemplation de ciels qui avaient, à bien des endroits, disparu. L’artiste
Bruno Gadenne avait déjà regardé tout cela de près, bien avant la crise. Toutefois,
il ne regarde pas que le ciel quand il peint ses paysages, et notamment ceux
des forêts primaires. Cet artiste, qui régulièrement s’en va parcourir les
coins les plus reculés du monde, en rapporte des peintures dont l’intensité des
couleurs trahit plus la menace que les beautés qu’elles suggèrent. Dans son
travail, il y a souvent l’incendie qui ravage les forêts enveloppées de leurs
ombres de la nuit, ou alors, dans ses gouaches, le ciel est marqué par le rouge
des tensions que l’homme fait planer sur les milieux naturels depuis des
années. On y sent frémir les radiations comme les inquiétudes du peintre, pour
qui le paysage n’est plus l’expression de nos émotions positives comme au temps
des impressionnistes. C’est bien plus la vibration de quelques idées politiques
qu’il conviendrait de soutenir, encore plus, après cette crise car on l’a
compris, le virus et sa propagation, sont d’abord le déséquilibre d’un certain
mode de vie qu’il s’agit de revoir, de fond en comble.
Galerie Provost Hacker
Cet homme
qui me racontait plus haut son escapade, et ses contemplations de ciel,
regrette déjà la fin du confinement et ce rapport au temps, qu’à marche forcée,
nous avons dû, pour beaucoup, établir : le temps de faire ou de ne rien faire,
on ne sait pas. Lui s’est dit qu’au moins, en promenant son cheval sans le
monter, juste avant la fin du confinement, il avait pris le temps d’observer ce
qu’il mangeait : sa monture, comme tout animal à moitié domestiqué, affichait
aucune hésitation dans ses choix de verdure dont la reconnaissance botanique
requiert pour l’homme une bonne dose de savoir :« Vous n’avez que les animaux
domestiques pour s’intoxiquer ! », me faisait remarquer le promeneur de destrier.
D’une, on
est loin de posséder le savoir des indiens Borobo, étudiés par Lévi-Strauss, en
terme de plantes médicinales, de l’autre, le trop de dépendance fait perdre, à
grande vitesse, les capacités de défense et d’adaptation, en milieu hostile :
c’est bien connu.
L’animal
domestique en est l’exemple même, à l’exception peut-être du lapin, le vrai,
pas le mini, qui, lâché dans le jardin, conserve son animalité, tout en émettant
quelques signes de contacts avec ceux qui l’ont accueilli : une sorte de
rapports assez intermédiaires entre le chien, pour qui le maître est tout, et
le chat, si libre qu’il en oublie parfois sa première maisonnée.
Sommes-nous donc bientôt dans l’après et la crise, si l’on pense les événements selon cette logique, va-t-elle produire quelques changements que beaucoup verraient comme salvateurs ?
Sommes-nous donc bientôt dans l’après et la crise, si l’on pense les événements selon cette logique, va-t-elle produire quelques changements que beaucoup verraient comme salvateurs ?
La crise
possède une étymologie grecque, et l’analyse de ce qu’elle représente est en
soi toute l’étendue des possibilités entre l’avant et l’après : un philosophe, François
Jullien, spécialiste de philosophie orientale et occidentale, en fait une analyse
comparative :
Selon sa racine grecque, la crise est ce qui « tranche ». Elle
est le moment critique et dramatique qui tranche entre des possibles opposés (…)
En chinois – c’est même devenu aujourd’hui une banalité dans les milieux
du management – « crise » se traduit par wei-ji :
« danger-opportunité ». La crise s’aborde comme un temps de danger à
traverser en même temps qu’il peut s’y découvrir une opportunité favorable ;
et c’est à déceler cet aspect favorable, qui d’abord peut passer inaperçu,
qu’il faut s’attacher, de sorte qu’il puisse prospérer. Aussi le danger en
vient-il à se renverser dans son contraire. De tragique, le concept se
dialectise et devient stratégique.
Certes,
stratégique mais pour qui ? La question est là. La
crise n’est-elle pas une belle opportunité pour faire passer ce qui, jusque-là,
ne l’était pas ? Accélération brutale des usages de vidéos conférence, des
téléconsultations et les commandes de produits en tout genre, par l’outil
numérique, s’affichent comme un effet de cette crise : déjà, pour certains, un
nouveau pas dans l’exploitation du virtuel, et on voit déjà frétiller, encore
plus vivement, ce qui n’était déjà plus des balbutiements mais bien les premières
vagues du tsunami. Ne perdons pas de vue que le monde numérique cache des
intérêts qu’on ne saurait pas toujours nous montrer !
Enfin, après
cette montée en flèche de l’intérêt des pouvoirs publics pour la santé, on
pourrait déjà penser à ce changement que beaucoup attendaient. Mais gare à nous,
me dit le spécialiste des questions sociales, financières et numériques qui me
fait ses bilans, toujours pertinents, avec une petite pointe de pessimisme. L’absence
de négociations fermes, en amont, peut coûter très cher, en terme de sacrifices
humains, d’épuisement et de jours qui déchantent. Il dénomme tout cela la
théorie de l’échec. Au départ, tout est réuni pour échouer–en l’occurrence, ici,
au début de la pandémie, absence de masque pour les soignants, qui œuvraient en
première ligne, absence de tests rapides, pas assez de moyens au niveau de la
réanimation. Jusque-là, tout le monde a bien été informé. Tout est alors
présenté comme une très grande catastrophe et les premiers signes n’ont pas
tarder à se faire sentir, notamment avec la surcharge rapide des lits de
réanimation. L’hôpital et son personnel, en grève peu de temps auparavant, montrait
déjà des signes de fatigue et l’implosion, à bas bruit, avait déjà eu lieu,
depuis longtemps, avec l’hémorragie du personnel vers d’autres secteurs. La
crise arrive, et par conscience professionnelle, la bonne vieille morale
transférée en éthique professionnelle–personne ne va flancher et donc on monte
sur le pont, on tire sur les cordes, on agite les voiles et on prie pour que le
mât ne se brise pas. J’ai à ce titre une situation remarquable. Avant la crise
du Covid19, le climat à la maternité était particulièrement tendu entre le
personnel soignant et le responsable infirmier du service, cadre décrié par toute
l’équipe. Ce dernier, pour une raison inexpliquée, préparant son départ ou je
ne sais quoi, s’était alors permis d’établir une liste de jugements sur ses
administrés, de commentaires et de critiques croustillantes.
Informelle,
cette liste est tombée entre les mains des concernés, soudain prêts à utiliser
ce document compromettant pour régler leurs comptes et rétablir un peu de
cohérence. La crise arrive. Par professionnalisme, tout le monde se met
d’accord pour temporiser afin d’affronter au mieux, par solidarité, cette
tempête. Celle qui me fait ce compte rendu explique qu’en mettant son poingt
dans sa poche, l’autre s’est levé, quelques temps après, quand elle a fait le
bilan des aberrations apparues, en cours de gestion de crise. La réaction du
chef ne s’est pas fait attendre : convocation, remontée de bretelles alors
qu’elle avait transitoirement enterrer la hache de guerre. La crise passée,
elle se doute que l’argument de la liste informelle, illégale, aura nettement
moins de poids pour lutter contre ce responsable peu scrupuleux puisque ça a trop traîné : piéger à son propre
piège. Un peu la même chose, à l’échelle de l’hôpital : par conscience
professionnelle, tout le monde se démène, au-delà de l’héroïsation, fait son
boulot, avec empilement des heures. Des promesses politiques et une enveloppe
soudain dédiée aux équipes, et par-dessus tout cela, une prime au mérite. Mais
il est peut-être déjà trop tard : « ils auraient dû cesser le travail, dès le
premier jour. Se mettre en grève, mettre la pression et négocier dans le dur
pour les années à venir », me dit mon analyste. Oui, mais par conscience
professionnelle, et par quelques obligations, puisqu’il s’agit de santé (on
peut être réquisionner.. !), ils ne l’ont pas fait. Pire, ils ont fait
preuve, au milieu des injonctions paradoxales, d’un certain nombre de capacités
à faire plus, d’abord avec moins, puis avec un système de réanimation transitoire
: une perfusion de quelques jours ou une injection en soi de tranquillisants. Le
retour à la normale peut conduire au bilan possible que malgré les plaintes,
les équipes étaient encore capables de bien mieux, justifiant par défaut qu’ils
n’ont peut-être pas tant besoin de ressources en plus, en temps normal. La
théorie de l’échec ! Ne pas avoir, comme au bon vieux temps des grèves minières,
cessé le travail, maintenant et tout de suite, c’est risqué ! J’ose espérer
que l’homme qui me fait cette analyse se trompe, largement. Il y a hélas des
signes qui exposent la fragilité du système et ses verrouillages possibles. Un
autre exemple. Un jour, à l’EHPAD, pour satisfaire le gouvernement, il y a peu,
l’ARS (agence régionale de santé) déploie un dépistage massif de Covid19 et pour le moins excessif
: ceux qui avaient déjà subi un test avaient des symptômes de la maladie. Les autres
allaient bien. Donc, sur trois jours, des tests en pagaille, personne ne sait vraiment
qui les prescrit, tout est confus : le médecin des résidents devient
médecin du travail, obligé de s’occuper aussi des salariés. Tous, résidents et
soignant, dépistés alors qu’à ce moment-là, aucun n’était symptomatique ; aussi,
avalanche de décisions, plus noires que le charbon, opaques, et, en arrière-plan,
des mesures faites pour soutenir le politique : il faut montrer des
chiffres, s’activer pour montrer qu’on pallie à ce qui a fait défaut, il y a peu,
mais sans aucun bon sens. Bilan quasi évident : aucun cas symptomatique, par
conséquent aucun test positif et par rétorsion locale, assumée, quelques
salariés ont refusé, à juste titre, le test, et certains testés ont même refusé
que leurs résultats soient mentionnés, même si c’était de manière anonyme. Le
résultat est clair pour l’ARS : sans l’ensemble des données, leur analyse est
bancale, voir le doute quant à des porteurs sains n’est pas levé. Une dépense
d’argent, de moyens pour rien, si ce n’est épuisé le personnel de l’équipe
médicale, poussé à orchestrer ce plan
vidé de sens. De même on a déjà oublié, en quelques semaines, que dans certains
départements, l’ARS avait mis la pression sur des EHPAD pour qu’ils donnent
leur masque et leurs médicaments aux hôpitaux, et ce, par la force, avec l’intervention de la
police : tout cela a été gardé secret. Certains ne l’oublierons pas, mais une
fois encore, on mesure combien tout cela est parti à vau-l’eau alors que, a
posteriori, l’on présentait déjà que les plus fragiles, face au virus, étaient
les personnes âgées.
Au même
moment, l’ARS, orchestrateur en chef d’une politique de santé dont les agents
finissent par s’y perdre, offre une autre stratégie tout aussi déconcertante.
Dans un IME, institut recevant des enfants porteurs de déficience, ils invitent
les professionnels et la direction à échafauder un plan de reprise alors que dix
jours auparavant, ils avaient refusé l’idée même que deux enfants, sortis de
chez eux pour faire souffler leurs parents, jouent ensemble. Autrement dit,
délégation de responsabilités ou l’art de se défausser transitoirement, sans
aucune ligne directrice et l’éventualité de ne rien valider, après exposition
du plan. On se demande alors comment la puissance publique, ultra technocratisée,
peut encore satisfaire ses administrés, depuis qu’elle définit ses actions en
terme de rentabilité et de gestion des risques. Il y a vraiment des modèles
d’organisation qui posent question, et surtout on se défie tellement de
l’humain qu’on veut en limiter au maximum tous les faits et gestes : c’est lui
qui est en danger, et c’est lui dont on se méfie le plus, en l’arrosant de
contradictions ou en infantilisant au maximum, considérant du haut de l’État quand
il est en première ligne qu’on peut pas lui faire confiance. On ne va pas
se mentir, le ciel de l’après va avoir, pour longtemps, du mal à être au beau fixe… !




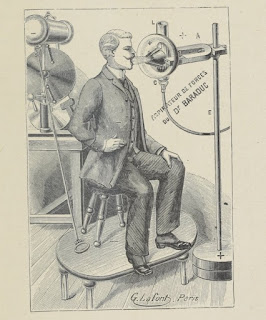
Commentaires
Enregistrer un commentaire