Une
nouvelle fois, que va-t-on conserver de tout cela, après un semblant de retour
à la normale ? Déjà beaucoup attendent de retrouver, tant que les foudres de la
récession économique ne les auront pas transpercés, un semblant d’habitudes.
L’homme est résiliant, dirait certains, mais surtout capable de souffrir le
pire, d’absorber les chocs, d’amortir les privations et de continuer comme si
le nœud coulant autour du cou, en se relâchant, donnait l’impression de
respirer nettement mieux alors que la corde est toujours là. Cette femme,
va-t-elle encore longtemps se souvenir que le confinement lui a fait vivre
l’expérience pesante de cohabiter avec sa fille, son gendre et leurs enfants,
en apprenant à se taire, et à constater sans rien dire ? « c’était le
confinement. Ça aurait été un enfer, si j’avais essayé de batailler. Ma fille
aurait pris le dessus. », exprime-t-elle. Leurs divergences dans le mode
d’éducation est évidemment acquis de longue date, - différence de générations oblige
mais là, elle a dû le vivre, et au quotidien, le subir : il fallait tout
accepter, l’enfant qui ne mange pas comme les autres, qui se balade à moitié nu.
« Il n’y avait pas de règles, juste on était dans le bonheur et les câlins
», dit-elle. Elle n’en pouvait plus de l’avion qui voltige, lancé par l’enfant
en culotte courte, qui n’en fait qu’à sa tête, écrasant au passage les fleurs,
massacrant le salon qui venait d’être refait et ce refrain pour tenir bon, qui
ressort, quand on ne maîtrise plus rien : « je ne voulais pas qu’on
s’embrouille car ses enfants, ce sont les prunelles de ses yeux. »
« On a beau être vulnérable, à l’intérieur, » ajoute-t-elle, « on
baisse pavillon. J’ai pris des coups, à me faire des bosses, j’attendais juste
un pardon qui ne venait pas. » Son constat est sans appel : « mes
petits-enfants se sont comportés comme des sauvages, dans ce semblant
d’éducation ! » Les règles à vivre différentes ont produit ce climat
pesant, dans cette communauté d’adultes et d’enfants, pas faits pour cohabiter,
ensemble, durablement. 15 jours plus tard, elle en parle avec toute
l’ambivalence qui la caractérise et qu’elle reconnaît en elle, comme son plus
grand vice : des moments de tensions et de calme, en alternance, car « c’était
quand même merveilleux d’avoir ses petits-enfants », ajoute-t-elle.
On est souvent rendu à ce constat, après des périodes difficiles : il y a du
bon, il y a du mauvais, l’esprit fait le reste, on chasse le pire, tant que
c’est possible, on ambitionne un avenir plus serein. Que va-t-on conserver,
dans quelques temps, de cette crise ? Il est dur de faire entendre que cette
ultra protection n’augure pas que du bon. Beaucoup s’en moquent et J., est le
premier à s’en offusquer. Je partage largement son point de vue. Les mesures
posées risquent d’engendrer le pire : les gens vont perdre leur travail, les
métiers les plus pénibles ont déjà vu leurs conditions se détériorer : voyez
combien, dans certains magasins, les vendeurs, affublés de visières et de
masques, en plus de plier et de réinstaller les vêtements, doivent les passer au
spray désinfectant, doivent nettoyer, à chaque passage en cabine, l’espace
occupé par le tabouret, portemanteau et la glace où l’on s’observe plus gros
que d’habitude, après deux mois confinés. Sans compter que déjà, les dirigeants
des grandes entreprises réfléchissent à conserver leurs dividendes, de manière
cachée, et les taxations sur les transactions financières sont nébuleuses. Et
surtout, le jargon économique, dans pas mal de journaux, empêche de saisir, si
on ne prend pas le temps de décrypter tout cela, combien le monde d’après va
ressembler au monde d’avant, sûrement en pire. J. a fait le choix de reprendre
des actions militantes ; il a bien raison : on est jamais si bien éclairé
que dans les lumière incandescente de l’action en cours.
« Pourquoi les hommes combattent-ils pour la
servitude comme s’il s’agissait de leur salut ? » écrit Deleuze, dans l’anti
Œdipe. En passant par Paris, on a bel et bien cette impression. Il est facile
de se tenir à l’écart, dans sa campagne ou son bord de mer, et se dire que « tout
va se régler, qu’ici, ça va, on a de quoi tenir, les conditions sont bonnes…. ! »
On ne regarde pas toujours plus loin que le bout de ses orteils que l’on fait
dorer au soleil. Tant qu’on est pas concerné, ça ne nous concerne pas – tautologie
auto-destructrice. Il y a ces deux oppositions : ceux qui veulent qu’on leur
foute la paix, tournés sur eux-mêmes et ceux qui, au cœur de leur chaudron
bouillonnant, se réchauffent, s’activent, et se préparent à l’action, guidés
par la colère du renouveau : le virus ne fais que révéler ces oppositions.
Deleuze, cité plus haut, aspirait à quelques ambitions de changements, dans
notre société, pour en dépasser les contradictions et les conflits. Il misait,
dans ses réflexions, sur les notions de lignes de fuite et d’agencements pour
penser la vie, sous forme de flux, de connexions, de compositions et de rapports
autour de ces notions « alliage, alliance, attraction, répulsions,
etc ». Cette logique des agencements
est faite, selon lui, pour rendre compte des mouvements de transformation qui
peuvent se produire dans une société, un individu, une vie.
La ligne de fuite désigne alors le potentiel de création, échappant au système,
en le déstabilisant : « C’est une invitation à construire sa propre ligne
de fuite, ou sa propre variation autour du modèle inspiré par les système de
pouvoir.. ! », écrit Deleuze.
Et bien
ces jours passés, bon courage ! Le temps n’était pas ouvrir des lignes de
fuite mais à supporter le quasi insupportable, c’était sûrement modeste, en
comparaison des scènes de guerre, d’attentat, de vie recluse en raison de
bombardements : rien n’était comparable ! On ne guettait pas le son
strident des missiles et leur explosion. C’est tout le paradoxe des analyses de
Deleuze et Guattari qui , pour penser la création, imaginent le concept «
de machine de guerre » qui consiste à ne pas se laisser domestiquer. Au titre
de la puissance de création, cette machine qui fonctionne pour elle-même,
et contre l’État, est libératrice tant qu’elle n’a pas pour objet la guerre :
cette machine doit occuper un espace propre et lisse et qui s’oppose à l’espace
strié de l’État. Une machine radicalement extérieur à l’État, et ce n’était pas
une gageure d’en imaginer, aujourd’hui, le fonctionnement et les perspectives.
Paris n’était plus une ville confinée mais une ville de mouvements, à outrance,
induits par l’État qui en avait fixé les règles transitoires
S’en souviendra-t-on ? Ce qui suit n’est déjà plus mais laissons ce tout juste
passé nous guider… !
Les monuments s’admiraient toujours avec leur éclairage savant, coupole des
Invalides presque dorée d’un état de survie, tout comme la coupole du Panthéon,
dominant ces rue animées de mouvements, de jour comme de nuit, pulsations troubles
d’un retour à la normale, et aux sorties sans limitation. Il faisait bon, ce
soir-là de début juin, mais les rues Lecourbe et Blomet, tout comme les
alentours de Montparnasse, semblaient gelées dans l’indifférence, de jour comme
de nuit, de ces automates que, transitoirement, nous étions devenus. Il était impossible
de s’arrêter, vraiment ! Aucun parc, aucun square n’était accessible, et
même devant l’hôtel des invalides, la large avenue de Breteuil, avec ses tapis
de pelouse, d’habitude coupés à ras, était cernée de barrières. Quelques
insoumis avaient enjambé le grillage pour s’affaler sur ces herbes folles dans
la perspective du monument qui abrite le mausolée de Napoléon.
Ce qui se lisait par ici, c’était le message suivant : marcher, bouger, en
somme circuler, y’a rien À voir. Tout ce qui faisait le bonheur d’une petite
halte n’avait pas lieu d’être, de jour comme de nuit. Avec les bars et
restaurants fermés, les musées passablement endormis, les salles de spectacle
dévastées, le cinéma éteint, il ne restait, (et il ne reste encore), qu’à
déambuler dans la carcasse d’une ville qui offrait, sur chaque trottoir, son
lot de badauds, en arrêt, qui attendaient, corps debout, de pouvoir entrer dans
un espace qui allaient les rejetter aussi vite qu’ils y étaient rentrés dedans.
Transitoire, tout cela ; on circulait, on déambulait et ces lignes de
fuite dont parlent Deleuze nous échappaient, elles se perdaient, elles s’éteignaient
même, d’un coup, comme le métro s’ arrêtait à 22h, rideau de fer tombé. Plus
rien à voir !
Il fallait marcher encore. Le plaisir était toujours là de découvrir Paris,
mais il lui manquait un supplément d’âme.
Aussi, que
dire de ce monde d’après qui ne rêve que d’éliminer les hommes de l’espace
public : le projet le plus ambitieux, dans tout un tas de service, pour leur
optimisation, est de limiter la variable humaine, trop coûteuse, trop instable,
trop chère. La ville de demain pourrait ressembler à ce mode de vie où tout
déplacement devrait avoir un but précis, où le corps serait actif, en
mouvement, son déplacement n’aurait de sens que si cela lui a été imposé pour
une raison précise ou incitée. La ville a parfois quelque chose de renversant
et d’écrasant. Et bien là, ces logiques furent poussées à l’extrême et elles
demeurent encore, pour certaines.
Dans le
métro, en trois stations, trois messages vous invitent à contrôler votre corps
dans un univers qui est pensé comme dangereux : une annonce pour le freinage,
violent, pensez à vous accrocher ! Une
annonce comme quoi tout est bien désinfecté, avec des produits « virucides »,
néologisme soudain élevé au rang des bonnes actions et vous devez tenir vos
distances– monde paranoïaque ; Et dire que certains pensent qu’on en fait
trop à dénoncer ces aberrations : « vous êtes un rebelle monsieur ! » et
dernière annonce–attention au pickpocket. En trois stations, vous comprenez que
la ville est truffée de dangers mais ils sont plus exagérés, surfaits que réels
ou plutôt, on devrait être capable de
s’en sortir seul mais non, on vous le dit, on vous le répète, comme il est
affiché que les violences conjugales n’étaient pas de sortie pendant le
confinement, comme si on ne le savait pas : tout est centré sur la menace, les
dangers en tout genre. Puisqu’on a massacré la création–cette belle ligne de
fuite–il n’y a plus aucune info sur les expositions ou spectacles à venir, dans
les couloirs du métro, tout cela est devenu superflu : on aura du mal à faire
croire à nos enfants, que c’était bien comme ça, vraiment, pendant plusieurs
semaines. Nous étions devenus des hommes en mouvement, d’un mouvement
perpétuel, infatigable, où le repos n’était permis nulle part, où ce qui comptait,
c’était d’aller d’un point à un autre, de s’arrêter pour quelques achats, de
commander un repas au restaurant réunionnais–un cari canard au chouchou et de
le manger chez soi, ou en marchant.
Paris,
pour un temps, avec la tour Eiffel habillée de paillettes, pour nous émouvoir,
sur un ciel noir d’encre, a pu ressembler à aucune autre perspective que celle
du Corbusier qui, dans son délire, avait imaginé raser le centre de Paris pour y
bâtir des tours gigantesques, un Paris défait de toute beauté et de tout charme :
la fonctionnalité avant tout… !
Le plan Voisin est un projet pour le centre de Paris, rive droite, dessiné entre 1922 et 1925 par Le Corbusier.
On ne l’ a
pas fait, heureusement, mais l’expérience aura existé, en ces temps viraux où
ceux qui se déplaçaient, majoritairement, travaillaient ou consommaient, comme
au milieu d’un monde guidé que par des objectifs précis et rentabilisés…!



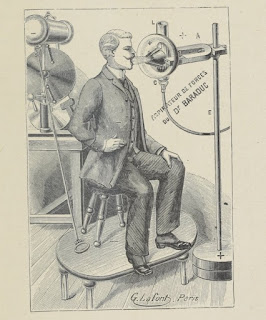
Commentaires
Enregistrer un commentaire