Avec le malaise ambiant et l’incertitude montante qui
plane, on cherche à se changer les idées. Je tombe sur un livre de photographies
de Léonard Misonne, un artiste belge, largement oublié, figure emblématique du
pictorialisme, un courant artistique qui visait début du XXème siècle, par ses
images de nature et de vie campagnarde, largement romancées, à évoquer la
douceur, le bonheur de vivre et la beauté des choses.
En fidèle défenseur de cet art de voir et de montrer, Misonne
donnait à la vie, près des vaches, sous les arbres, un sens quasi religieux. Ses
photographies, qui encensent la vie au grand air, renforcent leur pouvoir
d’attirance, par un léger effet flouté, le grain du tirage semble si épais que
les visions d’un chemin enneigé, ponctué de lumières frémissantes, sont
renversantes de poésie. La vie simple trouve ici tout son sens, un calme
profond. Simple vision, toutefois ! Une manière de porter son regard, focalisé,
convergent, à un endroit précis plutôt qu’à un autre. On ne peut pas renier le
pouvoir de la nature, celle que l’homme a façonnée. Ces derniers jours, avec la
suspension de la vie publique, comme on le dit parfois, la nature a repris ses
droits, les oiseaux n’ont jamais été aussi nombreux et présents, dans les
jardins, au sommet des haies resplendissantes, entre les genêts jaunis de fleurs et les orangers
du Mexique. Habillée de ce nouveau silence, à quelques pas de chez
nous, la forêt offre des perspectives insoupçonnées. Comme s’il respirait, on peut y
entendre le bois craquer. En même temps, à l’égal de Misonne, oubliant largement, à son
époque, de porter son regard photographique vers l’exploitation minière ou vers
la guerre, on pourrait se complaire de cette suspension : la nature enfin trouve
un second souffle.
D’aucuns diront, ça y est, on les retrouve enfin, ces
fameux temps ancestraux, temps d’avant, nostalgie brûlante où tout ce qui fait
la vie moderne aurait disparu : un retour à la nature, célébrée par Jean-Jacques
Rousseau, quand il filait le coton de sa mélancolie. Mais gare à nous, le sens
d’une certaine beauté s’effrite sans un certain sens politique !
Le muguet, avec ses clochettes, s’apprête à pousser
mais il est sûre qu’au 1er mai, en cœur et sans joie, on ne fêtera pas le
travail. On prendra sûrement conscience, une nouvelle fois, des inégalités de
traitement, dans ce contexte de pandémie.
Ainsi, tous logés à la même enseigne. Enfermés, depuis
des jours, regard unifié qui ne passe pas, me semble-t-il, trop peu de
considérations de la part des pouvoirs publics pour le sort réservé à certains.
J’en ai un très bel exemple.
Dans le sud de Paris, bordée par le périphérique, se
dresse la cité universitaire. Des bâtiments de choix, construits en leur temps
par de très grands architectes, dans des formes censées représenter les spécificités
de chaque pays du monde, ayant ouvert leur espace de logements pour leurs propres
étudiants : par exemple, des briques
rouge sablées et des bordures crénelées pour les pays du Nord et des colonnes
doriques, à l’entrée du bâtiment de la Grèce. Le Corbusier, aux idées
controversées, hommes farfelu et surtout ayant fricoté avec le pouvoir à Vichy,
antisémite à ses heures, a conduit sur cette cité universitaire un chantier
d’importance : l’élévation d’un bâtiment pour la Suisse, et globalement,
par sa taille, une des vraies réussites architecturales du Corbusier. Avec son
parc tout juste réaménagé, chemins bordés d’arbres, cette cité est un havre de
paix : les futurs intellectuels du monde, étudiant en soutenance, y dorment et y
batifolent.
Toutefois, dès le début du confinement, les mesures
déployées à la cité universitaire, furent des plus radicales et des plus
drastiques. Dans la mesure où des cas de Covid y furent recensés, les étudiants,
comme des rats, y ont été enfermés dans leurs 11 m². Ainsi, enfermés comme des
rats, on avait dû supposer qu’étant jeunes, aisément, ils supporteraient ce
régime : l’obligation de rester dans sa petite piaule blafarde et un usage
des cuisines communes régulées comme jamais : interdiction totale de s’y
retrouver, à plusieurs, en même temps. Une nouvelle aberration, en ce lieu, puisque
les jeunes, selon les informations à peu-près valides qu’on possède, sont très
peu à risque de formes dangereuses. Et le beau parc, évidemment, a été condamné
: condamné pour les étudiants et condamné surtout pour les joggers, nouvelles
figures soudainement insupportables de l’espace public.
L’homme qui m’explique tout cela, chargé de recherche,
était en contact, depuis le début du confinement, avec son étudiante, cloîtrée
sur place. Et puis, brusquement, plus de nouvelles de sa part. Un jour, deux
jours, trois jours passent. Aucune nouvelle. Pris par l’inquiétude, il alerte
le service de garde du site. Un agent est alors dépêché. Il s’en va rendre
visite à la jeune femme. Au fond de son lit, il la retrouve, alcoolisée, shootée
aux médicaments. Par conséquent, à deux doigts de la catastrophe. Pas besoin de
vous faire un dessin, quel qu’il soit, ou de donner d’explications plus
étoffées : elle n’en pouvait plus.
Des mesures de confinement, égales pour tous, sans
discernement et voilà donc ce qui peut se passer, outrageusement. On ne peut
pas sérieusement détourner le regard sur tout ça, même si la nature, taillée
par l’homme, modelée selon ses choix, sous quelques fenêtres, explose de
couleurs et de lumière, en ces temps obscurs où certains n’ont pas été enfermés
mais incarcérés. La vie à la cité universitaire est pire qu’en prison, comme le
confinement s’avère terrible en Afrique ou en Inde, où beaucoup gagnent leur
vie au jour le jour, ne bénéficiant nullement de prestations sociales de
compensation. L’épidémie est sans pitié car elle révèle nos défaillances et
surtout nos incohérences. La nature, elle, tant qu’on la regarde de loin, en a évidemment
que faire … !



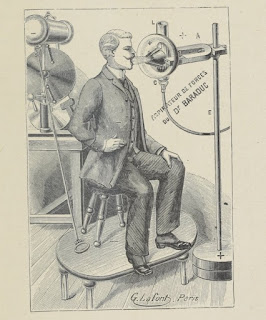
Commentaires
Enregistrer un commentaire