«
Tu écriras sur le bonheur »–un titre
de livre, un recueil d’essais, rédigés avec brio par Linda Lê. Un titre qui
sonne comme une injonction ou alors, au fond de soi, comme une obligation
d’être à la mesure de ce qui porte une vie, ou lui rend sa couleur, sa teneur.
Tous les auteurs auquel cet essai est consacré conjuguent fêlures et aspirations,
ombres et lumière, et le pouvoir de leurs mots, d’Ingeborg Bachmann à Knut Hamsun,
fouille les âmes humaines, en attirant à nous ce qui peut, de pas grand-chose, d’un
rien, provoqué ce petit bonheur, aussi éphémère qu’insatisfaisant, né à la
surface des tourments, ou dégagé d’une tranchée où l’on avait pris l’habitude d’acheminer
ses rêves pour mieux les enterrer.
« Le bonheur est une chose sérieuse. Il doit être
absolu », déclame Nanni Moretti, dans son film Bianca, en tant qu’homme
désabusé, mortifié par l’idée que l’amour n’est pas infini, que les couples,
souvent, se déchirent et se séparent. Dans son petit appartement insalubre, au
rez-de-chaussée d’un immeuble vieillissant, une femme tourne en rond ses
mauvaises pensées. Son périmètre habituel de promenade ou de circulation se
limite à bien moins d’un kilomètre autour de chez elle. Eh oui ! Je la
connais pour ses ruminations, pour ses incapacités, et chaque fois qu’elle doit
renouveler ses dossiers d’aide sociale, on dirait qu’une ombre s’est jetée sur
son visage : elle se décompose. Et à chaque dégât des eaux, chez elle, je
mesure dans ses paroles la vétusté de son domicile. Eh bien, depuis le début du
confinement, même si ses cheveux grisonnent, elle est radieuse - radieuse comme
on peut l’être, soudain, d’un petit bonheur passager.
Dans la cours arrière de l’immeuble, c’est par
petites grappes que tombe le soleil. Il n’atteint pas le sol, il l’effleure, en
le gratouillant puis s’échappe, cours humide où la mousse verte pullule. Depuis
le début du confinement, comme d’autres, elle s’autorise avec un voisin une
petite entorse aux obligations ; c’est la logique précaire des petits
arrangements. Tous deux, pour respirer un peu, s’y retrouvent : une table de
fortune, des chaises pliables, fragiles et instables, et chaque jour, le même
rituel du thé et des petits gâteaux secs. Sous le regard affectueux mais
distancé d’une autre voisine, ils passent ainsi le temps, ils discutent, ils
s’amusent, ils rient, pour son plus grand bonheur : elle en oublie ses pensées
négatives, ses sensations étranges, dans tout son corps, électriques, et ses
petites voix de la précarité. Déjà par le passé, ce voisin lui accordait un peu
de temps mais là, c’est constant, continu, quasi absolu comme le bonheur de Nanni
Moretti : « il doit être sans ombre, sans peine » ce bonheur, rajoute-t-il «
c’est difficile pour tous. Pour moi, il est impossible, je n’y suis pas habitué
». Comme on dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour
cette femme, l’isolement des uns fait le rapprochement des autres. Son voisin a
beau avoir, elle le sait, des attentes, fameuses attentes, elle ne se sent
nullement prête à les satisfaire. « Il est en manque, dit-elle mais ce
n’est pas grave. » En l’écoutant, on mesure néanmoins, à travers ces
petits moments passés dans la cour arrière sans lumière, combien l’ombre,
dessinée par le confinement, lui va, pour une fois, à ravir.
Depuis des semaines, elle aussi, vit confinée. C’était
bien avant les mesures drastiques, posée par l’État. La circulation, sur les
routes, en cas de bouchon, la pétrifiait sur place. Et l’idée même de mettre un
pied dans les transports en commun activait en elle un processus ingérable
d’angoisses et de craintes insolubles. Épuisée, elle avait démissionné de son
travail, au point de se mettre, par sa rigueur, son sens du devoir, dans la
difficulté : jamais l’idée d’être en arrêt de travail ne lui avait effleuré
l’esprit. Une rigueur, toute slave. Elle allait serrer les dents et tenir bon,
prête à se couper de tout, à s’isoler, auprès de son mari, plutôt conciliant.
L’isolement chez elle qui vient de si loin, de terres sibériennes, de la Russie
profonde, où la neige brille de douceur et de menaces, a une certaine valeur.
Elle avait décidé, il y a quelques années, de quitter son pays natal, de partir,
de s’éloigner, d’aller vivre ailleurs : un exil sans vraiment l’être, comme une
nécessité, ressentie en elle, un beau jour, - « c’est venu d’un coup,
dit-elle », comme ces choses qui parfois, sans savoir pourquoi, nous guident
et que l’on suit, à l’aveugle.
Elle parle si bien français qu’on mesure, en
l’écoutant, combien sa détermination, depuis le début, à se couper de son pays,
fut robuste. Ce n’était pas qu’une question d’intégration. Rien à voir. C’était
plutôt l’idée de se défaire voire de s’éloigner comme pour parer au sentiment
douloureux de la nostalgie. Elle avait fait un choix, et coûte que coûte, elle
l’assumerait, quitte à se couper de tout, presque de ses souvenirs comme de ses
habitudes. Le jour où je lui avais demandé ce qu’elle conservait, au quotidien,
de sa culture, de son pays, de sa vie d’antan, elle avait, pour ainsi dire,
derrière son visage souriant, légèrement hésitée : trop déroutée.
À son propre confinement, des mesures supplémentaires,
un confinement de plus, prophylactique, un horizon brouillé et alors qu’elle
avait envisagé retourner dans ses steppes, les frontières se ferment. Comme
certains disent, les pays s’immunisent, tiennent la menace viral à l’écart sans
penser à la coopération. Et voilà qu’elle, brusquement, voient ressurgir des
souvenirs, comme de hautes vagues, portés par un vent d’Est, qui reviennent du
large. Elle pense à sa mère défunte, elle pense à sa ville, à ses changements,
elle revoit ses prairies d’herbe haute, dans l’Oblast, les rives jaunes du lac
Baïkal, ou les sommets accidentés de l’Oural, et aussi, elle veut revoir son père âgé.
Elle y repense, avec le vent clair de la nostalgie dans ses cheveux. L’horizon
repousse ce qui lui manque. Ces derniers jours, ce qui fait défaut ouvre en
elle des vannes de lumière : elle repense à cette terre, à ses femmes et ses hommes
qu’elle gardait cachés en elle, à cette vie, rude, slave. Et c’est autant aux
lieux qu’elle aspire qu’à ce qu’elle a pu rater. Jamais elle n’a pu honorer
l’esprit de sa mère, selon certaines pratiques et rituels orthodoxes. C’est
comme si elle prenait conscience qu’il y a des choses dont on ne peut, ni on ne
doit, se défaire. À l’écouter, c’est comme si, plus ou moins, s’écrivaient des
continuités, rugueuses, franches : on ne peut pas se couper de ce qui nous a
fait, encore moins de ses morts que de ses anciens. Une société, quelle qu’elle
soit, et chacun de ses représentants, doit honorer ses morts et respecter ses
vieux.
Quand on voit, ces derniers jours, le sort réservé à
nos vieux, on a de quoi s’interroger. L’épidémie, sans aucun doute, ne
déboussole pas vraiment les logiques de notre société. Elle montre juste ses
failles, elle donne à voir ses profondeurs, elle expose ses entrailles, son
squelette et ses bases. Que penser ainsi de ses mesures qui d’abord excluent
les vieux, les plus démunis qui vivent en EHPAD ? Déjà relégués de base, on ne
leur offre pas de partout des soins de confort pour mourir dignement. L’État, détaché,
a d’abord regardé tout cela de loin puis, désormais, au sommet de l’hypocrisie,
via les médias, les EHPAD sont visés pour leur possible défaillance : petite ou
grande amnésie, ne serait-ce pas l’État et la société qui ont organisé, depuis des
lustres, ce système de gestion des anciens : ainsi déléguer pour mieux
critiquer. Le slogan n’a pas fini de se perpétuer. Chaque jour, on ne fait rien
de mieux que décompter le chiffre de la disparition des personnes âgées. Et pour limiter
l’hécatombe, on présage, pour elles, un horizon de fermeture, d’exclusion plus
drastique, jusqu’à les priver de visites, de sorties, et de considération, car
ce qui compte, c’est que les chiffres soient bons. Ceux qui sont notre mémoire
collective, nos anciens, sont relégués, toujours et encore plus. Quelle société
peut accepter de se détourner de ceux qui, à d’autres périodes, incarnaient la
sagesse et le savoir ? Il n’est pas question d’encenser les traditions mais je
mesure, une nouvelle fois, les incohérences.
Par les propos de cette jeune femme russe, de son
histoire, je mesure, une nouvelle fois, combien on est rattaché à un passé, à un
passé commun et l’Homme n’est pas fait pour s’en défaire. Certains représentent
ce passé, en sont les tremblements comme les blessures, incarnation de l’Histoire,
et l’on voit, bien plus nettement, en tant d’épidémie, où ils sont placés, dans
l’échelle sociale. Comment, de la même manière, accepter cette infantilisation
de tous les vieux, considérés vulnérables, qu’ils vivent chez eux ou en EHPAD, en
temps d’épidémie COVID-19 ? On les exhorte à rester chez eux, à s’enfermer,
pour une durée quasi sans fin. Corps inutiles ou corps surnuméraires, ainsi ils
ne doivent, en conséquence, pas emboliser les services de réanimation comme si,
par ailleurs, on visait à les déresponsabiliser entièrement. Ils n’auraient pas
leur mot à dire. Pas le droit de s’exposer, juste le droit de se cacher pour
quel bénéfice, pour quelle vie ! Sous peu, on va les accuser de ne pas être
sérieux, à sortir de chez eux ou à recevoir de la visite comme si vivre, pour
sa seule vie biologique, comptait bien plus que son libre arbitre ou son sens
de ses propres responsabilités. Peut-on dignement autant déconsidérés nos
anciens, ceux dont la mémoire est encore marquée par la guerre ? « Je
ne porterai pas de masques, j’en ai assez porté pendant la guerre ». La
parole est directe, celle d’un vieux qui s’exprime, haut et fort, dans sa
déroute, dans ces clameurs. L’épidémie révèle une nouvelle fois certes, qui
sont les corps à sauver, à entretenir et à rendre productifs. Mais les autres,
sur l’échiquier de la consommation production, comptent si peu. Toutefois, on n’osera
quand même pas les sacrifier, alors on va les infantiliser et les priver de
tout, comme de la liberté : ce sera toujours mieux que de les voir mourir,
tous ensemble, la morale politique sera ainsi sauvegardée.
Je crois qu’au fond d’elle, cette jeune femme russe,
qui projette de faire des enfants, fait l’expérience d’un impossible, d’un
inattendu auquel on doit, certainement, prêter attention. Il y a des choses à ne
pas renier, à ne pas oublier : la
place faite aux vieux. Sinon, une certaine amnésie pourrait nous coûter cher. Très cher.



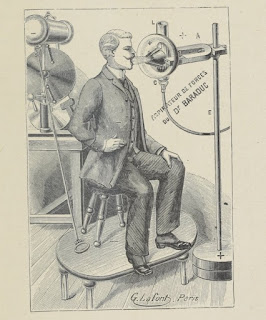
Commentaires
Enregistrer un commentaire