La jeunesse nous offre souvent de belles leçons de
vie. Depuis quelques jours, je fais le constat que de nombreux jeunes, adeptes
de la transgression, et surtout considérés très souvent comme instables,
immatures et incohérents, s’avèrent respectueux des consignes de confinement.
Ils font preuve d’un très grand sérieux, c’est notable, et j’admire leur
abnégation. Celle qui avait pour habitude de sécher les cours, d’en faire qu’à
sa tête, se révèle posée, et très magnanime. Sa relation passionnelle, qui
évolue depuis des années en dents de scie, n’a pas changé de dynamique : c’est
un jour oui, un jour non, à s’aimer et à se déchirer, sans cesse, grande
volupté des rapports houleux avec depuis toujours cette conviction, très ancrée,
profonde chez elle, qu’ils feront malgré tout leur vie ensemble : elle n’a
que 17 ans et elle sait déjà que c’est l’amour de sa vie. Un jour, tout va
bien, ils se parlent par téléphone et via les réseaux sociaux, un jour, ravivée,
leur querelle accouche d’une fermeture de tous les canaux de communication. Au
milieu de tout cela, entre deux épisodes, de surcroît, apaisés, ils se retrouvent.
Et je vous le donne en mille : ils se retrouvent au super U, dernier espace,
dernier lieu, dernière zone pour leur idylle : ensemble, pour quelques minutes,
ils tirent leur panier rouge en plastique, anse noire qui coulisse mal, passant
d’un rayon à l’autre, à se regarder et à s’aimer. On parlait, il y a peu
encore, des supermarchés comme des gares ou des aéroports, comme étant des
non-lieux, c’est-à-dire des espaces sans possibilité de lien véritable, où l’on
patine dans les zones froides des chassé-croisé. Voilà là, pour une petite
touche de beauté, la dernière manière de ré-enchanter le monde, transitoirement…
Ainsi s’accroche-t-on à ce qu’on peut… !
Une autre, tout juste plus âgée, fait le constat que
le confinement, pure et dur, outre qu’il aggrave ses problèmes de sommeil,
attise et emballe sa machinerie à cauchemars : « je ne mets à rêver, ces
derniers jours, de manière sordide, je rêve aux gens que je n’ai pas vus depuis
des années comme cette ex meilleure amie, cette espèce de connasse… ! ».
Histoire trouble de relations amicales ayant progressivement dévié, déception à
la clé, et le sentiment, à l’époque, qu’elle l’avait trahie, au cours d’une
soirée, la snobant, la martyrisant, et surtout l’ayant laissé en plan, parti de
son côté avec un Uber alors qu’elle prétendait éperdument être fauchée.
L’isolement, à tourner chez soi, quelles que soient les conditions, réveille
sûrement, car elles nous font défaut, nos relations sociales, des plus fortes aux
plus distordues : notre inconscient s’éveille au chant de ces complaintes,
obscures, tendancieuses, dans un monde, en plein dérèglement. Pour dire, on
m’explique ainsi que dans les derniers numéros des revues juridiques, il est
question que du covid, des décrets qui tombent, en regard de l’épidémie et des
nouveaux codes de lois. A l’image des revues scientifiques de médecine, il n’y
a plus que ça qui compte. Dans un éditorial, une juriste, plutôt bien capée en
terme de diplômes et de statut, dans son langage un peu austère pour les
non-initiés, limite abscons, explique qu’aujourd’hui, dans ce contexte, on peut
mettre de côté les valeurs d’égalité et de liberté : seule valeur d’importance restant
à soutenir, la fraternité. En trois semaines, voilà comment, à la vitesse de
l’éclair, on martyrise les fondements de notre société. Certes, si l’on regarde
le monde des dons, en tout genre, arrivant par cargaison à l’assistance
publique des hôpitaux de Paris, dons de saucissons, don alimentaires en tout
genre, dons dans tous les sens, dons de je-ne-sais-quoi, on se dit « ah
oui », il y a aussi un vent de solidarité. Mais passer la porte de
l’hôpital, avec les délation en tout genre, comme cette famille, à Lapalisse,
près de Vichy, dénoncée par les voisins car venue se réfugier à la campagne, je
dis bien près de Vichy, ce qui a fait la une des journaux locaux car toute la
famille a été verbalisée et renvoyée chez elle, en région parisienne, on
s’interroge sur le sens même de la fraternité, prise isolément, détachée de
tout le reste.
Et que penser de la fraternité à l’heure où certains,
comme cette vieille dame, à l’entrée d’une jardinerie faisant aussi office de
magasin alimentaire, qui demande à la première caissière qu’elle trouve et à la
responsable du magasin quand est-ce qu’ils vont dédier des horaires
exclusivement aux personnes âgées. La pente est plus que glissante, dans ce
système de catégorisation, notamment quand on sait pertinemment que l’infection
ne sera contrôlée que si une grande partie de la population se trouve immunisée,
et pour lors, le seul remède, et c’est ainsi, c’est de s’immuniser, en l’attrapant,
avec les risques qu’individuellement on encourt.
Car, au rythme où vont les choses, on peut
s’embarquer, vaille que vaille, dans la barque de quelques supputations, avec
ce genre d’idées et celles que portent nos gouvernants. La catégorie
aujourd’hui la plus à risque de l’attraper et de le transmettre, quels que soient
les moyens déployés, ce sont les personnels soignants, ainsi que le personnel
d’entretien des hôpitaux et des EHPAD, en première ligne, puis les caissières,
livreurs, en second ligne et j’en passe. Tous ces gens seraient donc assignés à
la catégories des dangereux, dans l’espace public. Pour dire, en Espagne, des
voitures de soignants ont été vandalisées : les graffitis, laissés sur l'un des voitures, traitaient le soignant en question « de sale rat
contaminé »…. !
En région parisienne, particulièrement dans les EHPAD,
le personnel d’entretien mais aussi les aides-soignants, comme les infirmières,
tout comme les livreurs, les éboueurs, appartiennent à ce qu’on se considère,
de manière politiquement correct, aux minorités visibles : autrement dit, les
noirs voir les arabes. Je le dis trivialement car c’est comme cela qu’ils sont
considérés. Et bien, proportionnellement parlant, ils sont à l’hôpital et dans
les EHPAD, majoritaires, par rapport au grand nombre de médecins blancs. Donc,
si l’on fait un horaire pour cette large population dangereuse, applaudie par le
peuple, chaque soir, à 20h, à sa fenêtre, acclamés à coups de cuillère en bois
dans une casserole, par glissement, ou par défaut, ce serait l’horaire pour les
noirs et les arabes. Je fabule certainement dans notre société où les
défenseurs des libertés et des inégalités savent se battre mais les idées germent,
en ce moment, à une vitesse telle qu’on se demande bien ce qui peut, vraiment, arrêter
leur nocivité sociale.
On peut s’afficher ainsi, sournois, sans problème
aucun pour la défense de la santé donc pour la vie comme si tout cela, comme
une évidence, primait sur tout le reste.
11
avril
Notre corps nous appartient-t-il ? Nombreux se risquerait
à penser que oui, évidemment ; c’est mon corps, celui que je façonne, en
fonction de mes activités, de mon travail, celui que je me maquille ou que je
recouvre d’étonnants tatouages, celui que je décide de soigner ou pas, que je peux
maltraiter, en fumant trop ou en me jetant dans des pratiques sportives
dangereuses ; ce corps dans lequel je vis est le mien.
En fait, par la vie qui nous anime, nous
ne sommes que simplement dépositaire de ce corps: il nous a été alloué. Ce
n’est pas « poussière tu redeviendras poussière », c’est plutôt une matière
vivante, qui passe et qui restera vivante, à notre mort, sous une autre forme. Dur
à croire, dans notre société, ce principe que ce corps n’est pas à nous,
entièrement. Mais pour démontrer le contraire, j’adore cet argument qu’un de
mes professeurs de psychiatrie et d’anthropologie s’évertuait à répéter : il n’est
pas possible de faire ce qu’on veut de son corps, notamment il est impossible
de se mutiler sans aucune raison, se couper un doigt, par exemple, et dire, « on
s’en moque, ça m’appartient, donc je tranche ». L’ordre social vous fera
passer pour fou, même sans maladie. Et surtout après
notre trépas, en laissant quelques "directives anticipées", on ne peut pas envisager de faire comme bon nous semble de notre corps. Il est en effet impossible
d’exiger qu’il soit, sitôt trépassé, jeté dans une poubelle ou dans la forêt.
Notre corps, à ce moment-là, ne nous appartient plus. Il appartient au groupe
et à la communauté. C’est elle qui décide de la gestion et du devenir du corps,
par des règles et des rituels, très encadrés. Et on traite de ce corps, et surtout
le mort, avec d’autant plus de soins et de dignité qu’il en va, le jour des
funérailles, de l’intégrité du groupe. Comme l’écrivaient Marcel Mauss et Émile
Dürkheim, aux funérailles, on y pleure moins par tristesse que par obligation sociale
de faire corps autour du défunt. La mort met ainsi le groupe à l’épreuve, il
renforce et réactive ses liens, autour de tous les rituels possibles et
inimaginables, comme celui de se retrouver dans un bar, tous ensemble, pour
boire un verre, en mémoire du défunt. Or, avec ce qui se passe concernant
l’épidémie, les rituels funéraires ont été drastiquement limités. Surtout,
comme une épreuve de plus, les corps contaminés sont traités d’une manière qui
rend compte autant de la crainte de la contagiosité que du malaise qu’on a
laissé, à grande vitesse, s’installer.
Un homme meurt à l’EHPAD du covid 19. Inconnue
jusque-là, une société de pompes funèbres débarque. Ce ne sont plus les
consignes de prévention qu’ils suivent, qui plus est sous le regard terrifié de
quelques soignants (prêts à dénoncer leur manque de respect), c’est bien pire.
Le sac, censé accueillir le corps, a toutes les caractéristiques du sac à
ordure. Aux deux extrémités, les agents tirent dessus, à les tordre, comme on
fait habituellement tourner le sac plastique poubelle quand on le ferme, avec
ce long fil translucide qui traîne, des jours durant, au cul du sac, au fond de
la poubelle. Ils opèrent de la même façon, aux pieds et à la tête de la
dépouille : le corps n’est ici plus qu’une masse dangereuse. Ensuite, jeté parterre
sur une couverture, ils tirent le corps dans tout le couloir, sans même
chercher à le mettre sur un brancard car ils n’en avaient pas. Pliée en deux
dans l’ascenseur, la dépouille n’est plus qu’un amas de viande qui va
retrouver, deux étages plus bas, un cercueil qui aurait dû être monté : la
mise en bière est automatique. On voit le malaise, petit artefact pour
certains, d’une grande catastrophe. Quand une communauté ou un groupe n’honore
plus ses morts, selon certains codes, et ne traitent pas avec dignité les
dépouilles, c’est l’équilibre de cette communauté qui est alors gravement en jeu.
Il y a donc le traitement et la gestion des
corps morts et puis il y a la manière dont on veut déjà, par souci de
régulation générale, gérer les corps vivant, face à l’épidémie. L’idée d’un
passeport sanitaire ou d’une application visant à mesurer la potentialité de
rencontrer des gens porteurs ou à risque de l’être, est une belle fantaisie de
comment l’État, garant de notre santé par tous les moyens sanitaires qu’il a pu
déployer depuis des décennies ( faire vivre) pourrait devenir comme le propriétaire
de notre corps, par quelques détournements. C’est lui qui déciderait ainsi, à
travers ce petit stratagème numérique, qui on peut fréquenter, avec qui on peut
interagir, dans quel lieu on peut se rendre. Par cette opération qui vise à
identifier notre immunité vis-à-vis du Covid ou de notre potentiel de
contagiosité (le passeport sanitaire, ce serait la mise en place des données
corporels–vous êtes immunisé, non-immunisé et malade) et l’application
soi-disant par Bluetooth, histoire de se différencier du gouvernement chinois
qui le fait par géolocalisation, donnerait à un temps t la mesure de qui est
fréquentable ou pas. Notre corps, à ce titre, sera-t-il encore notre corps,
dans ce contexte-là, puisqu’on ne pourra pas en faire ce qu’on en veut, qui
fréquenter, avec qui interagir ou coucher…. ! Déjà, ces dernières années,
les assurances et prévoyances commençaient, de façon incitative, à offrir de
bons points à ceux qui pouvaient prouver
qu’ils étaient en bonne santé. Aussi, pour bientôt, par les applications qui font
état de nos déplacements et de nous mouvements, ces assurances pourraient exiger
des preuves que l’on fait bien de l’exercice physique : en quelque sorte, ils
sont en train de s’approprier notre façon de vivre, de nous mouvoir et donc une
part de notre corps. Sans compter que le smartphone, objet de consommation par
excellence, et surtout de fonctionnalité aux vertus personnelles, qui était l’objet
du choix, pourrait devenir l’objet de la contrainte : obligation de se
déplacer avec, d’en avoir un, et l’Etat réfléchit déjà à comment équiper tout le
monde ; le portable n’aura plus jamais la même symbolique : de la
liberté d’appeler et de communiquer, de surfer, à la contrainte d’être identifié
comme corps malade ou corps sain…. !!!
Et bien là, en quelques semaines, au déconfinement, si
cela devait se passer ainsi, notre corps aura été vendu, et ce qui le conditionne,
à des stratégies, dignes des films de science-fiction : l’application sera
comme l’extension de notre corps et une alerte viendra définir que nous sommes rentrés, tout d’un coup, dans une zone grise de danger. Mais quel danger ?



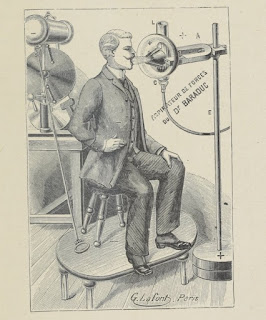
Commentaires
Enregistrer un commentaire