3 avril 2020
« Les périodes de décadence sont, me dit-il, les
périodes les plus claires, celles où les hommes se reconnaissent. Aujourd’hui,
ils ne se reconnaissent plus. ». Propos de Paul Éluard, rapportés par Jean Follain,
jeudi 21 novembre 1940.
Remarque
pour le mois inspirante, en ces temps de crise où, du reste, rien n’est comparable.
Comme le disent certains anciens, ces derniers jours, ceux mêmes qui malgré les
directives arpentent les rues, papotent, cherchent la relation, on est chez soi
au chaud, on mange bien et on attend. Rien à voir avec les heures sombres de
l’occupation où pour les juifs et les résistants il fallait fuir, se cacher, et
où aussi, écrasé par les ombres, il fallait ramer dur pour trouver de quoi se
sustenter. Les toits étaient de chaume et les espoirs, de paille, certains
soirs quand on allait se coucher, la faim au ventre. Pour autant, un point
commun, certes à des niveaux différents, mais un beau point commun demeure :
une nouvelle fois, l’incertitude. Aucune prévision n’est fiable, en terme
d’épidémie, et encore mois, en termes économiques : écroulement puis
rebond, un jour ou l’autre, en forme de cloche ou en toit d’usine inversé ;
la reprise n’a pas de vérité. Les modèles se démultiplient. Et ce qui prête le
plus à sourire, dans cette débâcle, c’est que l’outil le plus adéquate de ces
dernières années, qui fait tourner les bourses, qui régente et analyse de
nombreux comportements, notamment commerciaux et de consommation, s’avèrent
complètement dépassés : l’algorithme, comme une multitude d’entreprises, est à
l’arrêt ou tourne au mieux au ralenti. L’algorithme, si pertinent dans tous ces
modèles, n’est quasiment plus d’aucun secours pour savoir, avec la précision du
scalpel, comment la pandémie, mais aussi l’économie, vont évoluer et se
comporter.
On
multiplie les modèles, mais tout ce système, créé par les ingénieurs et les
technocrates, basé sur la prévision, s’est autant dérégulé que largement
bloqué. Tel le moteur qui sert, en surchauffe, courroie de distribution cassée,
ce modèle prévisionnel est à la peine. Et tant mieux, peut-être ?
À ce
titre, un homme qui travaille dans une grande groupe français, m’en donnait une
belle illustration. En règle générale, au cours de leur réunion hebdomadaire une
figure, dans leur équipe, se détachait: Jamais très inspirante, voix monocorde,
commentaires et demandes de métronome : le contrôleur de gestion.
Archétype
du modèle prévisionnel, en passe d’exploser et qui sans aucun doute a fait
exploser nos moyens de défense et d’actions, tellement il est répandu de
partout, des entreprises aux institutions de services publics, hôpitaux et
force régaliennes etc. Jusque-là, comme d’autres instances de contrôle, le
contrôleur de gestion exigeait des chiffres - ses chiffres. Ces fameux chiffres
qui lui permettaient, séance tenante, de prévoir et d’anticiper les commandes
et les achats. Il tenait les rênes du système comme ceux qui, à la tête de
l’hôpital ou d’autres services publics, exigeaient et exigent encore plus (tout
en étant perdus) leurs sacro-saint chiffres pour mettre dans leur tableur
Excel. Les chiffres, et l’impression en somme, d’avoir bien fait les choses.
Mais là,
comme tout est à l’arrêt, que les factures ne sont pas toutes réglées, que rien
est entièrement recouvert, que même une mise en demeure n’a aucun sens - poste
au ralenti et courriers par toujours relevés, le contrôleur de gestion est
gravement perdu. Il est même déboussolé à un point tel qu’au cours des réunions
de télétravail, de ces derniers jours, il s’est enfoncé dans un silence
religieux : il ne dit plus rien, son cadre a sauté, et à l’égale de tous ces
gens qui ont déserté le terrain, ou qui en sont très loin, qui ne comprennent
pas vraiment ce qu’est la réalité, leurs
capacités de réadaptation frisent la nullité. Les grattes papiers ne savent
plus où ils en sont et c’est peut-être tant mieux. Signe de la future
obsolescence de ce modèle, on espère, l’exigence des chiffres, remontés du
terrain, s’est malgré tout, ces derniers jours, emballé ; dernier chant du
cygne, peut-être ? On me racontait par
exemple que pour la gendarmerie, sur le pied de guerre, à pister les fraudeurs
sans attestation, on exige d’eux, non pas des chiffres à la semaine mais à la
journée, quasi à l’heure : on délire, tout simplement. Emil Cioran, cynique
comme jamais, pensait souvent aux désastres de ces certaines fonctions ;
en voici un commentaire dans son journal : « Et quand je pense à cette race maudite de fonctionnaires qui
emploient leurs journées à s’occuper de choses qui ne les regardent pas, qui n’ont
rien de commun avec leurs soucis ou leur être même ! Personne, dans la vie
moderne, ne fait ce qu’il devrait faire, ce qu’il aimerait surtout. Et quand je
pense aussi que le paysan est en voie de disparition ! Décidément, rien ne
pourra jamais me réconforter avec l’avenir de l’homme. » (Cahiers, p 91)
Cette mise
en veille de la vie publique risque d’accoucher de modèles, modifiant nos
rapports, et accélérant aussi, c’est sûr, des privations et des reculs. Ou
alors, ce qui faisait office de grandes exceptions pourrait devenir la règle,
comme la télémédecine et ses grandes limites, ou le télétravail, et sa rigueur,
sa raideur et sa lente déshumanisation.
L’homme
qui m’en donne un aperçu reconnaît pour lors d’être chanceux, contrairement à
d’autres qui sont à l’arrêt : il travaille, gagne toujours bien sa vie.
Toutefois, le simple descriptif d’une journée de télétravail, donne le tournis,
malgré des règles fixées ensemble, entre collègues, comme une heure commune de
début et de fin, une pause déjeuner, une heure sans connexion réseau Internet
pour travailler dans son coin.
Les
écouteurs vissés dans les oreilles, câble fixé dans la machine, ce sont les
yeux qui travaillent sur l’écran, sans relâche. Concentration continue sur
cette micro fenêtre avec, non pas l’interdiction mais l’impossibilité de goûter,
pendant les réunions, le plaisir des cimes si la salle donne sur des arbres.
Là, impossible, le mauvais débit, les images troubles de la visio-conférence,
obligent un niveau sans égal de concentration. Tout est plus compliqué,
ralenti, malaisé qu’une réunion de deux heures peut prendre le double. Le
télétravail donne la même sensation que par le passé, quand enfant, en
l’absence des parents, on pouvait passer sa journée, la tête et sûrement les
yeux, enfoncés dans la télévision. Le soir venu, abruti, on en ressortait, la
tête farcie et les yeux rougis qui piquaient. Le télétravail, outre la
difficulté de fixer la frontière entre vie professionnelle et vie privée, risque
d’accoucher d’une belle monstruosité, aux yeux lessivés, au corps avachi. En
quelques jours, dans ce contexte, à vitesse accélérée, on en prend la mesure.
En
confinement, on profite par les fenêtres du printemps, en pleine éclosion. Le
lilas, au soleil, apparaît plus violacé, les jonquilles, plus jaunes et ce ciel,
sans artefact blanc, dépourvu de ses rubans de kérosène lâché, illumine notre
vie enfermée. Au moins, on en profite pour échanger un peu plus, les
discussions, quasi toutes, ont une étincelle de politique : chacun y va de son
opinion, on échange des idées, on critique, et aucun expert patenté, qui montre
sa tête dans les médias, n’occupe une place centrale : c’est quasi un jeu de pousse-pousse ;
et bien sûr, soit on s’y perd, soit comme beaucoup, on se retranche, par de-là
les vitres claires, dans le silence des rues calmes.
Quelques
mots échangés avec L. Et soudain, un nouveau constat, une nouvelle aberration.
De partout, sauf exception, sur le territoire français, les marchés à ciel
ouvert ou les marchés couvert, se sont trouvés arrêtés et suspendus alors que
les centres commerciaux, appartenant à de grands groupes, cotés en Bourse, à
l’origine de pas mal de catastrophes écologiques, continuent de vendre, en exposant
les petits salariés. Où sont donc passés les petits producteurs, avec leurs
légumes sales, leur culture raisonnée et leur effort pour que nos assiettes
concentrent une densité saine de nutriments et de belles initiatives ?
Disparus
ou alors sommés sûrement de vendre autrement, dans les marges, par des
tentatives désespérées d’animation locale des réseaux, connus ou inconnus, avec
ou sans solidarité, ou alors à se saigner en vendant à bas prix leur
marchandises aux grandes surfaces, ou alors, pour les moins débrouillards, ils
regardent leur production se ratatiner, jour après jour, dans des abris de
fortune, petit hangar en bois flotté. Une nouvelle fois, des décisions sans
scrupules qui avantagent certains pendant que d’autres croupissent, sous leurs
belles initiatives, censées repenser notre rapport à la terre, autrement et
surtout plus éthiquement : les plus forts (et j’ose à peine dire les plus riches)
s’en balancent.
Heureusement,
le confinement accouche de quelques drôleries. Un jeune homme de 13 ans, pas
encore pubère, en passe de l’être, avec son léger liseré noir, au-dessus de la
bouche, se présente. Je le rencontre pour la première fois. La scolarité, en
confinement, institue soudain ce qui se trame depuis des années. Les parents,
en capacité de le faire, sont exhortés plus que jamais (comme c’était déjà le
cas) à devenir des auxiliaires de
l’éducation nationale : vérifier et faire faire les devoirs, signer le registre
des notes, motiver les troupes et pas qu’un peu, faire avec et pis encore :
tout cela, parfois, atteint un tel niveau que la pression ne retombe jamais. Au
contraire, elle s’infiltre des deux côtés : du côté parents, et du côté enfants,
et souvent, ça s’auto-entretient et ça s’autoalimente. De ma position
professionnelle, je parle en connaissance de cause.
Or,
avec le confinement, même si chez beaucoup les efforts sont de mises pour
éviter la surpression, il devient de plus en plus compliqué de tenir ses nerfs.
D’un coup, pendant le cours d’anglais que la mère orchestre de main de maître,
c’est l’explosion pour ce jeune homme : ainsi, ordinateur fermé avec
fracas, quelques mots convulsifs de colère et autour de la table du salon,
dédiés aux travail scolaire et pas qu’aux devoirs (le confinement a tout
changé), tout est suspendu, subitement : la mère s’en arrache les cheveux. Le
jeune homme, d’ailleurs, me raconte qu’au premier trimestre, c’était la
catastrophe, des huit, des neuf, et sur tout ce trimestre, pas la
moyenne.
Le confinement
s’est imposé, sa mère s’est donc mise, à ses côtés. Ils font ainsi les cours
ensemble, regardent les vidéos choisies par les professeurs pour illustrer
leurs cours, aussi elle s’attelle, pour plus de vigilance, à mettre en œuvre
les leçons et les devoirs et à y participer. En moins de 15 jours qu’il n’en
faut pour le dire, les notes grimpent, et dans un ciel étoilé de dépassement, elles
flamboient : c’est magique, son niveau grimpe aussi. Il est fier. Il est fier
mais je lui fais alors la remarque de choc qui lui fait arborer un beau et
large sourire : « ce ne sont pas vos notes mais celles de votre mère. Elle est retournée
au collège n’est-ce pas ? ». Il acquiesce volontiers, et pour animer encore
plus la plaisanterie, devant quelques notes moyennes qu’il me cite, je lui fais
constater, en plaisantant, « qu’elle aurait pu faire mieux. Elle ne s’est
pas foulée ». En somme je me dis en riant, pas si facile que ça, le
collège, quand on a 45 ans. Avec le confinement, et surtout pour ceux qui
profitent de moyens technologiques adaptés, car c’est loin d’être le cas – inégalités
en trombe, pas mal sont donc retournés au
collège et mesurent, avec fracas, leurs lacunes. Merci Monsieur le ministre !
Retour
dans la rue. Le mouvement des corps y est stupéfiant. Celui qui nous croise, en
pleine course, ne devrait pas être là. Il a transgressé les horaires de la
préfecture. Pour autant, après nous avoir dépassé, il enfonce avec tracas son
menton et sa bouche dans son foulard, sorte de bandana à la Renaud. Peur de la
contagion, n’est-ce pas ? L’autre que nous sommes est si dangereux qu’on a
envie de lui demander pourquoi il a donc pris, comme ça, ce risque de courir
sur la voie publique. Il faudra bien qu’il comprenne qu’on devra tous, un jour
ou l’autre, l’attraper.



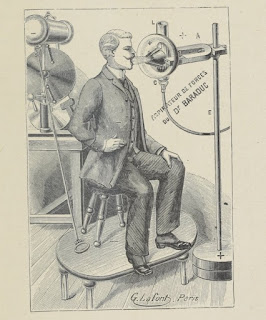
Commentaires
Enregistrer un commentaire