25 mars 2020
Je ne fais
que me repasser en boucle cette idée, suggérée par un homme vu la veille par
vidéo conférence, selon laquelle le coronavirus ne serait qu’un virus
capitaliste qui tue les vieux, préserve les jeunes et expose les pauvres.
Cynique la remarque a de quoi faire gamberger, quoique décalée. Elle rejoint,
néanmoins, sur un autre plan, celle d’un autre jeune homme, quelques semaines
auparavant et que je renvoie aussi la veille : Il s’était, un instant, à
l’époque, tortillé les cheveux, en signe d’embarras, avait lâché un grand
sourire, un peu nerveux puis il m’avait balancé sa remarque : « s’il y a
quelque chose qu’on doit se dire concernant le réchauffement climatique et la
catastrophe écologique que nous vivons, c’est que le monde est surpeuplé. » «
Peut-être qu’une bonne infection soulagerait la planète» avait-il lâché, gêné.
Entre les lignes, il l’avait dit, il fallait pour lui attendre une hécatombe. Bien
évidemment il était conscient du côté terrifiant de sa remarque ; c’était
moins par conviction que par cynisme qu’il s’était laissé aller, lui aussi, à
ce type de raisonnement. Je voyais bien ce qu’il voulait dire. Comme lui je me
disais quelque part qu’il fallait rééquilibrer les choses, en terme de vie
planétaire, d’écologie, de mode de vie mais de quelle manière, avec des États, tous
aussi sourds les uns que les autres, sur certaines urgences. Et bien, hier,
quand je l’ai revu, en pleine crise sanitaire, je n’ai pu que lui faire
remarquer que je ressassais, depuis quelques jours, notre discussion : sa
vision était pour le moins prophétique. On y est. Un virus, à l’échelle de la
planète, fait des ravages, et il le fait autant sur nos modes de pensée que sur
la vie elle-même, contrairement à ce qu’on nous laisse penser.
Le jeune
homme en question, cette fois, sourit, encore plus largement à l’évocation de
tout cela : « oui, c’était un peu prévisible…. !». La pandémie de coronavirus
peut-elle nous faire prendre conscience des vrais urgences, comme le répète ce
jeune homme, quand on voit que les dauphins retrouvent certaines rades, qu’ils avaient
abandonnées depuis si longtemps, qu’on voit des eaux troubles, redevenir
limpide pendant que l’Humanité, une grande partie–2,6 milliards, a ralenti, s’est
terrée chez elle : l’hibernation chez l’homme, en plein printemps, accouchera, peut-être,
de quelque chose de très bon.
Dans la
forêt derrière chez nous, encore atteignable dans les limites qui nous sont
imposées, le silence lointain est rondement vertueux. Les jacasseries des
oiseaux, de retour, haut perchés, jamais entendus ainsi ont de quoi raviver la
flamme d’un espoir. Certainement, ne soyons pas naïf, ce n’est qu’une accalmie
mais c’est si bon…. ! Le documentaire, notre
planète, conseillé par le jeune homme plus haut, adepte d’écologie
participative, est renversant de beauté, avec ses images animalières,
grandioses, de si près, jamais pour certains animaux obtenues jusque-là – les
drones ont du bon mais le documentaire est traversé, et surtout truffé, à chaque
minute, d’indices comme quoi il y a urgence. Le glacier, géant, du Groenland, qui
sous l’effet du réchauffement, avance toujours plus, se fracassant, en millions
de tonnes de glace, n’est pas sans pouvoir de conviction.
C’est donc
par le haut de la beauté terrestre que le malheur prépare ses lames, les
affûte. L’ours blanc, fatigué, qui avance dans un brouillard de neige, pèse le
poids d’une détresse, il n’est que l’ombre noire, traçante, pétrifiée, de ce
qui pourrait nous attendre. « Dix ans de retard, oui nous avons, dit le jeune
homme en question, dix ans de retard en terme de prise de conscience voire plus
» « il y a eu Greenpeace, il y a eu des écologistes, il y a désormais les
collapsollogues : En effet, aujourd’hui, l’écologie, après avoir été dans les
marges, se centralise : on écoute ceux qui portent ce genre de discours mais
n’est-ce pas déjà trop tard. Pour les collapsologues, ce qu’ils disent sera
peut-être pris au sérieux, là aussi, pense ce jeune homme, quand il sera déjà
trop tard. Espérons que le confinement ouvre les portes de quelques consciences
de plus : tout cela est fait, peut-être, pour que l’humanité, sous les coups
des gouvernements devenus totalitaires, s’autorisent à penser ce qui se passe :
espérons… !
Une chose
est sûre : le temps n’est pas à la réflexion. Les peurs ravivent les fausses
idées, les hommes, pour certains de nouveau, régressent se jetant sur le papier
toilette et finissent par trouver quelques comportements ignobles, afin de
soi-disant se protéger eux-mêmes. C’est ainsi qu’on me raconte que
l’hôpital de Thonon, à Paris, pour préserver les infirmières de trop longs
déplacements, du fait des conditions pénibles de travail avec l’épidémie, avait
mis à leur disposition des appartements dans des copropriétés, à proximité de
leur lieu de travail. Par la plus grande des bassesses, par ce qui se fait de
plus ignoble et de plus cynique, certains habitants de cette copropriété ont
fait des pieds et des mains pour les chasser
comme on chassait au Moyen Âge, les impies ou les sorcières, jugées
malsains et dangereux. L’homme jamais ne changera, toute catastrophe réactive
les mêmes comportements. Dans le même sens, les soignants des EHPAD, qui rentrent
dans leur quartier populaire, rasent les murs, le soir. Pour beaucoup ils se
sentent menacés par tous ceux qui les considèrent comme potentiellement
contagieux. En quelques jours, par tout ce foin politique et médiatique autour
de l’infection, on a ainsi, à une vitesse folle, reconstruit toutes les bases
des rapports humains, et même les soi-disant plus censés (ceux qui
pensent… !) y vont de leurs petits mots d’aggravation des choses : C’est
ainsi qu’une philosophe mettait en exergue, dans un entretien pour un quotidien
national, qu’il fallait qu’on prenne vraiment conscience, au vu de la
situation, de notre vulnérabilité face au vivant, oui certes mais surtout,
ajoutait- elle qu’ on devait aussi se préparer et assumer, en âme et
conscience, que nous étions devenus une menace pour les autres, notamment pour
les plus fragiles. En nous, désormais, par cette infection, nous aurions un
potentiel de dangerosité. Je crois sincèrement qu’elle a trop lu et trop
disserté sur le sida. Son propos n’est qu’une forme d’atteinte à l’intégrité
des hommes, en les sur-culpabilisant, surtout pour un virus de cette nature-là.
Comme si, déjà, par le passé nous n’avions jamais été porteurs de germes ou de
virus, dangereux pour les autres. Belle apologie, en creux, de l’aseptisation
des rapports. Déjà que par certains côtés, ce n’était pas toujours glorieux
avec le numérique, alors là, avec ce genre de manifeste, on va finir par se
déplacer dans des combinaisons de cosmonaute… !
Les plus
déboussolés n’y comprennent plus rien mais conservent, en eux, un certain sens
pratique. La mère de C. qui pour le dire simplement perd la boule « elle déclavette
sans cesse » ne se rappelant de rien à court terme–mémoire dans les
chaussettes, dans ses particularités ainsi lésées, n’a pas compris pourquoi son
fils la saluait de loin, du fond du jardin, et lui transmettait à elle et à son
mari, par la fenêtre, quelques masques et les consignes qui vont avec. Vraiment
elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas embrasser son fils : « mais
tu es encore mon fils » lui dit-elle « mais maman, si j’ai le virus, si je suis
infecté, je peux te le transmettre » lui expliqua-t-il. Mais quel virus, mais
quel histoire ? De quoi n’allons-nous pas mourir ? C’est là le souci de soi que
les plus altérés ont perdu. La raison ne se retrouverait-elle pas dans la
parole de déraisonnés ? Je crois que c’est encore possible. J’écrivais à L. que
le monde était devenu fou. Elle me répondit qu’il ne faisait peut-être que
montrer son vrai visage. Je crois bien qu’elle a raison, tout s’accélère, à une
vitesse folle. On nous enferme et on nous assène de discours complètement
délirants, de culpabilité outrancière au point de faire de notre corps la bombe
à retardement d’une catastrophe pour les autres.
Heureusement,
dans tout cela, il y en a qui s’y retrouvent. La belle-mère d’un patient, ces
derniers mois, se terrait chez elle, elle ne sortait plus, tenait des discours
pessimistes. Aujourd’hui, avec cette menace qui s’infiltre à la vitesse d’un
échange numérique, coup de tonnerre dans un ciel noir, elle ressort, se balade,
deux fois par jour (alors que c’est limité à une seule sortie ) et même,
irradiant de joie et de bonheur, elle alpague les passant pour leur parler.
Comme quoi…. ! Elle aussi, déclaveté, trouve le chemin de la rédemption et
par sa douce folie d’antan, nous le montre : on ne va pas quand même pas tout
aseptisé.
27 mars 2020
Un gros
ballon bleu, aux parois fines, gonflé au souffle, voltige dans le jardin. À sa
surface, écrit en blanc, un joyeux anniversaire, répété une bonne dizaine de
fois. Il voltige, sous les coups d’un petit vent passager. De la fenêtre, ou plutôt
de l’ensemble des fenêtres de la maison, je l’observe effectuer sa danse, tout
autour, à la chorégraphie improbable, tenu à peine par les barrières du jardin
et les murs de la maison. Ses déplacements, itératifs, désordonnés, dont il est
mathématiquement impossible de définir l’évolution, impossible, me font penser
à l’incertitude globale qui règne en ce moment : c’est en effet le cas, on
baigne dans une belle mer salée d’incertitudes où, à chaque mouvement de
surface, on ne sait pas quelles seront les conséquences à venir, notamment de
ses ressauts de vagues, tantôt douces, tantôt fracassantes. Et c’est plus
l’incertitude des décisions politiques qui inquiètent. Les hommes ont peur,
beaucoup se camouflent derrière des masques ou des gants de fortunes, en allant
faire leurs courses comme s’ils découvraient, pour la première fois, la
fragilité de l’existence. Se protéger est-il un bon réflexe, induit par certaines
peurs qui viennent des autres ?
Peut-on se
protéger de tout et à quel prix ? La recherche de sécurité est à cet égard une
bonne manière de mesurer combien on est prêt, pour satisfaire ce principe, à se
priver, à s’enfermer, à se ratatiner au fond d’un terrier. Je suis sûrement
idéaliste ou inconscient mais doit-on vivre, en se disant sans cesse qu’il faut
tenir à distance cette idée qu’on est vulnérable et mortel. Peut-être on l’a
oublié ou dénié, à large échelle, avec les progrès de la médecine et d’autres
progrès, cette vérité, fondamentale, essentielle qui fait qu’on devrait se dire
que chaque jour n’est pas forcément le dernier, comme le suggéraient des
philosophes antiques mais que chaque jour doit être, à bien des égards, un
accomplissement. Accomplissement d’avoir aimé, d’avoir aidé, d’avoir écrit, d’avoir
produit, d’avoir pensé, au sens d’avoir le lendemain, au lever, ce sentiment
que nous avons laissé derrière nous, la veille, quelque chose dont on peut être
satisfait et qu’on retrouve, sous nos yeux ou dans notre tête comme une trace,
un signe de notre existence, investi pleinement. (Hier j’ai laissé derrière moi
quelques aquarelles abstraites, l’excitation au petit matin tient à ce plaisir
de les retrouver, pêle-mêle sur une table, là où je les avais laissées sécher,
en pleine nuit, sous une lumière de lune froide)
Au rythme
où vont les choses, on peut se laisser aller à quelques distorsions. Le terme dystopiques,
utilisé de plus en plus souvent pour caractériser des créations romanesque ou
cinématographiques qui poussent la réalité dans ses pires déformations, est
complètement d’actualité si l’on force, s’il en est, quelques raisonnements, en
train de naître et quelques règles, dont on nous applique déjà le principe.
Avec une telle contagiosité de l’infection, on peut de base supposer qu’elle ne
va pas disparaître, du jour au lendemain. La propagation, en dépit du
confinement, n’est sûrement qu’à ses débuts. À ce niveau, on est pas encore
dans la dystopie. Tout cela reste tangible, et fortement, au vu de l’expansion
mondiale. Ce qu’il est moins, mais toujours possible, et qui fait dire que ce
ne serait pas de la science-fiction, c’est que la société s’organise autour de
ceux qui en sont porteurs, malades ou sains, ceux qui en sont indemnes et ceux
qui en sont immunisés. Le délire totalitaire, reposant sur cet état,
consisterait à savoir au temps T quel est notre statut. Il s’agirait alors de
faire des tests de dépistage. Jusque-là tout va bien, même si déjà en Chine, on
géolocalise les gens et on leur interdit de circuler si on a repéré qu’ils étaient
passés dans une zone à haute contamination – Aussi, pour endiguer toute
propagation, ou pour parer au risque
d’être dangereux pour les autres, l’exigence de l’État serait clair :
connaître, à l’instant T, notre statut viral. Le délire commence à prendre
forme : premièrement, on pourrait exiger que chacun possède sur lui un document
de moins de trois jours, si on est sain et non immunisé, ou sain et immunisé
qu’il s’agirait de présenter soit à des forces de l’ordre, soit à des agents de
sécurité, gérant certains contrôles de filtration, de façon à nous faire entrer
ou pas dans certains lieux collectifs. Notre téléphone pourrait, de même,
servir, le cas échéant, à présenter notre statut biologique. Ce serait ainsi
notre identité biologique qui conditionnerait nos déplacements voir notre
confinement. Il y aurait ainsi toute une cartographie de l’espace, gérée par la
police, dans une forme avancée voire très avancée de bio pouvoir. La police
contrôlerait notre possibilité de circulation, à l’aune de ce statut
biologique. Dans l’espace public, nous serions des corps nus ou plutôt cette
vie nue dont parle si bien Giorgio Agamben, à savoir que seul notre état
biologique, dans la société, ne pourrait compter, à défaut de tout le reste–nos
droits, notre vie sociale, notre vie de relations. Une dystopie, à portée de
main, sous peu, que l’on pourrait généraliser aux passagers des frontières :
mêmes obligations, en somme à l’échelle internationale.
Elle ne
sait pas trop pourquoi elle a eu cette vocation de s’occuper des enfants. Elle
réfléchit, un instant puis tout d’un coup, tout lui revient. Ses
grands-parents, qui avaient connu les deux guerres, toute leur vie, s’était
engagés auprès de la Croix-Rouge. Un investissement sans bornes, soutenu,
continu, de longues années durant comme un lointain écho, assourdi, dont on devine
pas les sons mais qui exprime un rapport douloureux à la guerre et à ces
conditions, aussi oscillant, battant même le tambour de la réparation comme
celui de l’engagement. Elle ne sait pas très bien ce qu’ils ont connu, si ce
n’est leur exode, de la zone occupée à la zone libre, fuyant la présence
allemande. Ce fut si fort et si douloureux pour ses grands-parents et pour sa
tante, devenue pour elle une mère de substitution qu’à la maison, des années
plus tard, il était formellement interdit de parler de l’Allemagne. Il lui a
même été sévèrement reproché de vouloir apprendre au collège la langue de Goethe.
Elle a vite compris, et elle a laissé tomber. La guerre a laissé ses traces :
les femmes et les hommes, ayant connu au moins l’occupation, enfants, ces
derniers jours ont accéléré leur manière de faire des stocks et des provisions
comme si un réflexe archaïque venait d’être réveillé et stimulé. Quant à elle,
elle s’est dévouée, par respect pour ses grands-parents, en référence à leur altruisme,
à s’occuper des enfants cabossés par le handicap. Je me demande quelle trace
laissera donc cette pandémie, ce confinement, dans l’esprit de la jeunesse
actuelle. Si l’on considère que le confinement n’est que le seul moyen aux états
pour pallier à leur défaillance, en terme de gestion des besoins sanitaires, on
peut espérer que les sociétés mettront au premier plan, au centre de leur
fonctionnement, autre chose que la consommation, les finances, le profit, le
tourisme de masse et j’en passe : le covid 19 provoquera-t-il une révolution de
fond ? On peut en douter mais qui sait. Les « survivants », comme
certains se nomment déjà, devront aborder le monde et surtout la planète et ses
hommes, bien autrement. Je dis survivants sur un ton un peu ironique car déjà
certains ayant surmonté la maladie, utilisent déjà ce terme pour fixer leur
état d’exception, dans cette tourmente. Que seront les autres ? On se
le demande.
28 mars 2020
Observer
la manière dont est géré l’ouverture de la porte de la boulangerie est en soi
une belle comédie du quotidien, en ces jours de confinement. Contrairement à ce
qui se passe dans d’autres lieux, encore ouverts, comme les banques ou le
boucher, personne n’a pensé dans cette boulangerie à bloquer la porte, avec une
brique ou une grosse pierre, de façon à ce qu’elle demeure en permanence
ouverte. Personne. Ou peut-être que frileuses, devant ce petit vent du nord qui
vient de faire son retour, les boulangers ont opté pour une absence de
changement. Il faut donc, dans tous les cas, pour celui qui veut s’offrir sa
baguette croustillante ou sa tarte abricots pistaches, ouvrir la porte. C’est
là qu’un bal démarre, jeu de mains, jeu de pieds, jeu de coudes, extraordinaire.
L’un hésite à toucher la large barre de bois qu’il suffit habituellement de
pousser, la main à plat : une petite barre vissée la verticale avec deux cache
à chaque extrémité. Il opte alors pour la vitre sur laquelle il pose sa main à
plat, espérant à la fois que le verre n’a pas été effleuré ou touché à cet
endroit–peu de chance–et que le virus, bien que résistant, se dissout sur les
plaques de verre transparente.
Certains y
vont avec le coude pour pousser ou le petit doigt pour tirer, notamment en sortant.
La sortie est parfois une belle promesse de contorsions entre celui qui sort,
retenant la porte, d’un doigts et celui qui entre, qui lui aussi cherche à
pousser ou repousser la porte mais qui, copieusement, en se faufilant de
profil, évite celui qui sort. Et c’est sans compter sur ceux qui oublient, à
leur sortie que la porte se pousse dans un sens de l’épaule par exemple, mais
se tire dans l’autre, à leur grand désespoir. Puis il y a ceux qui, voyant la
porte encore ouverte, se faufilent, comme la petite dame qui me suit. Vieille
dame, de celle à qui l’on limiterait volontiers les sorties, sujet à risque. On
dirait qu’elle s’en moque comme bien d’autres vieux qui, à son égal, arpentent
les rues, à la recherche de quelques contacts sociaux. Tout ça est bien plus
vital pour eux. La veille, à la banque, dans le sas confiné des machines à retrait, une dame de 70 ans prenait son temps et
n’a pas pu s’empêcher de me soutirer quelques mots : ça devait être, en temps
de confinement, sa seule bouffée d’air. Enfin, faut-il le croire.…
La vie
quotidienne est devenu un champ d’exploration très circonstancié facilement
descriptif : il se passe tellement peu de choses : le croustillant est
rare comme le pain ou presque, qu’on ne s’arrache pas. En effet, sur le
trottoir, les uns derrières les autres, à 3 m de distance, on attend. Comme des
couillons, on attend dans le vif d’un vent qui pose sur nos joues des baisers
piquants.
29 mars 2020
Pas de tri
en France, il n’y aura aucun tri, s’est exclamé, il y a quelques jours, un
ministre… Une semaine plus tard, foutaise. Dans l’EHPAD de M., un homme, fièvreux,
en quelques heures, se met à « désaturer ». Dans le langage médical,
cela veut dire que l’homme oxygène de plus en plus mal son organisme. Grosso
modo il est en souffrance. A ce rythme-là, en quelques heures, il va être en
détresse respiratoire. Son organisme peut littéralement flancher. Les mesures requises
ont été actées: oxygène à haute dose et quelques traitements de confort. Malgré
ça, son état s’aggrave. À ce niveau-là, seule une intervention du SAMU
permettrait de l’aider, au mieux : possibilité d’une ventilation assistée, et d’autres
techniques, plus ou moins invasives. L’infirmière, au chevet du malade appelle
M., médecin gériatre. Cette dernière, prenant la mesure de l’urgence, n’ayant
aucune directive anticipée de cet homme et de sa famille, doit s’en remettre au
service du SAMU. Aucune négociation possible, le médecin du SAMU est fixé sur
sa position : il ne se déplaceront plus : c’est fini. Ils sont débordés,
épuisés, et il n’y a plus de lits de réanimation disponible. Ils ne feront plus
rien pour les EHPAD. Que les gériatres se débrouillent, un point c’est tout s’écrie-t-il,
dépassé. Il n’argumente même pas. Sa seule défense est de se jeter, à cor et à
cri dans son discours, contre les pouvoirs publics : « criez haut et fort »,
exhorte-t-il, « il n’y a plus que ça à faire. Les politiciens nous mentent, il
nous mentent quand ils disent qu’il y aura bientôt des tests pour tout le monde,
c’est faux. On est dans la merde » dit-il, encore une fois. Rien à faire, pour l’heure,
il ne démordra pas de sa position. Le tri commence par là. Les vieux, un peu ou
très vieux, vont être les premiers sacrifiés. Il va falloir sortir la trousse à
soins palliatifs si tant est qu’elle soit présente : hypnovel, scopolamine en
sous-cutanée, une lichée de morphine, l’ensemble saupoudré d’oxygène. Merci
l’Etat… ! Dans ces marges, se révèle ainsi une triste vérité : il n’y a
pas les moyens adéquats pour tous alors qu’il faudrait des équipes d’urgence,
spécialement dédié aux EHPAD. On a eu beau le signaler à l’ordre des médecins,
personne n’a répondu, n’a bougé, aucune réponse, rien même si dans d’autres
départements, localement, on se débrouille mieux.
D’un côté,
ça s’enlise jusqu’au haut du bassin, remous de sable mouvant pendant que
d’autres rédigent, planqués comme jamais, cachés, des directives sur la gestion
voire sur la régulation même de la vie à la maison. A ce titre, j’ai vu passer
une plaquette de « bons comportements à la maison pour gérer les
enfants ». Il faut continuer à réguler : les services publics sont en
pleine dérive. Et ils ne trouvent rien de mieux que de fixer la manière de se
comporter chez soi. Un pas de plus vers les régulation de l’intime. C’est
d’autant plus risible, trivial que ceux que j’ai pu écouter, ces dernier jours,
savent très bien s’organiser alors qu’ils étaient encore, il y a peu, les plus
inadaptés du système. Sauf, bien sûr, à quelques exceptions près comme cette
jeune fille, qui n’arrive pas à aller sur les forums mis en place, se trouvant débordée
par des mails des profs, malgré leurs efforts, plein de contradictions, a envoyé
balader sa scolarité. « Je suis, dit-elle, déjà en vacances. » Les
réseaux sociaux l’aident à vivre le confinement : les romances, en dépit
des restrictions, perdurent et c’est pour le mieux.
30 mars 2020
Le
confinement fatigue. Même sans activité intensive, on se sent épuisé. S,
derrière les vitres léchées par le soleil, passe une bonne partie de
l’après-midi à dormir. Le confinement pèse sur les corps et sur les esprits qui
se vident de leur élan et de leur substance. Surtout les inquiétudes relatives
à cet enfermement, jouent à plein régime sur nos profondeurs. On éprouve, en nous,
ce qui fait les poussières de cette catastrophe, qui circulent dans l’air, nous
traversent, se prennent au piège en nous. On vit, submergé par ce flot
d’inertie étrange. Le silence de la rue, devant chez nous, offre un aperçu
lointain de ce qui se passe de partout. On sommeille dans l’incertain, pesant
et nuisible, comme du poil à gratter qui nous passerait dans le dos, jeté là, par un petit farceur, qui aurait tiré sur
notre maillot de corps.
1er avril
Après le
délit de solidarité, forme soupçonné du cynisme contemporain, appliqué à ceux
qui aidaient des sans-papiers, leur offrant toit et couvert, quand ils redescendaient
de la montagne, après une traversée des cols, hautement dangereuse, il y a, en
ces temps de crise sanitaire, le défi de solidarité. Je dis bien le défi et pas
le déni.
Concernant
déjà la solidarité, nombreux chez eux se sentent impuissant, qui ce pompiers,
en arrêt, bientôt à la retraite. Il suit sur WhatsApp les tribulations de ses
collègues pompiers, entre dépassement et inactions, au chômage concernant les AVP
(accident de la voie publique), et sur-sollicités par les cas de fièvre en
début de confinement. Qui, cette jeune femme, étudiante qui se confronte chez
elle à la désorganisation de l’université, avec des professeurs démissionnaires
qui ne proposent rien et d’autres, à la pointe de la technologie, qui savent
dispenser leur cours, sous des formes adaptées à la jeunesse contemporaine :
vidéo, forum et autres ; on voit là les disparités.
Avec sa
famille, cette jeune fille fait le constat, ces derniers soirs, qu’ils sont
impuissants. Leur élan de solidarité ne trouve aucune prise. Il n’y a rien à
faire, rien. Ils ont beau se démener, difficile de se rendre vraiment utile, si
on est soignant même si on ne l’est pas. Il y a des endroits sous dotés, du
personnel hospitalier épuisé et ailleurs, c’est le trop-plein. Elle me fait
remarquer qu’une amie de ses parents, infirmière, a proposé ses services comme d’autres
: ils se sont retrouvés à six dans une unité et en fin de journée, se marchant
dessus, quatre ont été renvoyé chez eux. Alors en agitant tout ce qu’ils
peuvent pour aider, cette famille se rend à l’évidence qu’ils ne peuvent aider
qu’en donnant de l’argent, un petit don, un peu, mais où et à qui ? Nouvelle
complexité.
Je crois
qu’ils sont loin d’être les seuls dans la même situation, enfermés, impuissants,
observer une situation critique sans rien pouvoir faire. Le matraquage
politique sur l’état de guerre n’a fait qu’aviver certaines peurs, mais aussi
certaines solidarités, sans trouver d’ancrage. Mais là n’est pas le comble du
comble. C’est encore plus cynique, à l’image des régulation de notre temps, en
ces temps obscurs. Pour des élèves en kinésithérapie, dont le stage a été
suspendu dans le cas du confinement, on leur aura fixé, clairement, une nouvelle
forme d’obligation : être solidaire. Je dis fixé, on peut dire exhorté et
imposé. Aussi, alors que c’est compliqué de trouver à se rendre utile, et donc de
trouver un moyen de se rendre solidaire, s’ils ne le font pas, ils ne seront
pas validés de leur stage : c’est le défi même de solidarité.
La sœur de
la jeune fille, évoquée plus haut, s’est trouvée face à cette injonction
farfelue, désadaptée, incompréhensible : elle devait trouver un lieu de
solidarité pour valider son stage. À la solidarité, ça se choisit d’abord et en
aucune façon on peut la mettre en balance vis-à-vis d’une validation d’un stage
dont la suspension dépend d’une décision d’État. Nouvelle fois, on marche sur
la tête. La sœur, pressée par cette injonction, a donc passé une série
invraisemblable de coup de fil. Après de nombreux refus, essuyés en raison
d’une absence de besoin, elle a réussi à décrocher une action : pour une pharmacie,
elle va livrer chaque jour des médicaments à des personnes qui ne se déplacent
pas. C’est déjà ça, se dit-elle quelque chose de concret, contrairement à ses
proches qui se perdent dans ce confinement.
Il y a des
rencontres, ou des figures, notamment jeunes, qui plus est dans ce contexte,
qui sont inspirantes. Sa mère déplore ses crises de nerf, quand elle part en
vrac, pestant contre elle, et surtout contre les autres, quand sa fille ne
parvient pas à boucler un devoir ou qu’une contrariété quelconque survient sur
son chemin. Aussi, un grand classique, la mère de cette jeune fille de 15 ans
en prend plein la figure. Au milieu de l’œil du cyclone, elle en prend pour son
grade. Sulfureuses, les réactions d’emportement de sa fille n’ont rien de
nouveau, et encore plus, quand vivant profondément une situation d’injustice,
cette dernière prend tout cela très à cœur. À la fois, on peut la considérer
comme très expressive et surtout, jamais depuis toute jeune, elle ne se laisse
faire. C’est vrai pour les petits aléas du quotidien que son père rapporte que très
jeune, se rebiffant face à l’autorité, elle s’était retrouvée placée au milieu
de la cour, seule sur une chaise, en guise de punition face à sa rébellion. Les
éducateurs qui avait orchestré ce mode de punition et d’humiliation, n’avaient
fait qu’attiser son goût pour la rebellions : l’injustice, à 7 ans, la rendait
déjà dingue.
Quelques
années plus tard, c’est toujours la même mécanique. Médusés, les parents, plutôt
introvertis, ont du mal à faire face aux explosions de nervosité ; tout bonnement,
ça les dépasse. À la maison, ils ont une rebelle. Aussi je me demande d’où
vient cette façon d’être, interrogeant les parents. Ils ne savent pas sur
l’instant. C’est certainement pas du côté maternel « ils ne se disent pas les
choses, ils évitent les conflits » nous dit la jeune fille. Les parents
réfléchissent et soudain, bingo. Le père a son idée sur le sujet. Son propre
père a toujours été du genre rebelle, défiant l’autorité. Son histoire est
marquée, à ce titre, d’un fait qui aurait pu lui coûter la vie. Jeune appelé,
au début de la guerre d’Algérie il s’étaient opposé à prendre les armes. Il
faisait même tout pour défier l’autorité militaire, en désaccordant dans son
fusil, le montant à l’envers, en le rendant inexploitable. À l’époque la
sanction fut sans appel : envoyé au front, à se faire tirer dessus par les
premiers Fellagah, sans utiliser, en retour, pour se défendre son arme
défaillante. Il échappa au pire alors que le père de Madame, quant à lui, connut
la guerre, aussi en tant qu’appelé, mais à la fin : ce fut nettement plus rude,
il en parle peu. Et pour dire il y a beaucoup d’appelés, comme on le sait, à
qui on a ordonné de faire le sale boulot. Voici donc, dans cette généalogie, du
côté paternel, un bel exemple de révolte, trouvant sa présence dans un acte de semi
désertion.
Aussi, en
écoutant tout cela, une évidence, à mes yeux, en ressort : il y a des
tempéraments qu’on ne doit pas forcément canaliser, sinon où serait la
contestation ; et notamment la contestation que l’Histoire sera jugée, à
posteriori, comme juste. En ces temps de crise, dans tous les sens, la valeur
de la révolte, et ce qu’elle apporte, est à mes yeux essentiels. Cette jeune
fille l’incarne, on peut espérer qu’un jour, y donnant un certain sens, donnant
un certain sens à ce qu’elle ressent, elle la jette dans une belle et grande
cause, en prenant fait et cause pour un bien commun, dépassant tout, sans se
laisser berner par de faux discours. On se dit alors qu’on a bien besoin,
actuellement, de ce genre de tempérament. Car, à la vitesse où tout va, en ce
moment il n’est pas improbable, comme le fait remarquer P. que cette crise accouche
d’un relent de populisme ; on sait ce qui s’est passé, dans les années
1930 et même si les spécialistes s’évitaient, ces derniers mois, les
comparaisons hâtives, aujourd’hui, avec les ingrédients de cette crise, on peut
penser que les idées fascistes refleurissent comme jamais. Les peurs sont à un tel niveau qu’elles vont
devoir trouver un terreau où se répandre : les peurs, c’est comme une mauvaise
graine, ça a besoin de quoi se perpétuer et vivifier. Les discours d’extrêmes
droites, en raffolent, des peurs, ils en font leur beurre : aussi, celles qui
courent en ce moment, ils vont les faire
fructifier, c’est le moins qu’on puisse penser, si on ne prend pas garde.
Aujourd’hui, plus que jamais, les visions réductrices, cherchant des coupables,
peuvent bientôt pulluler.
.



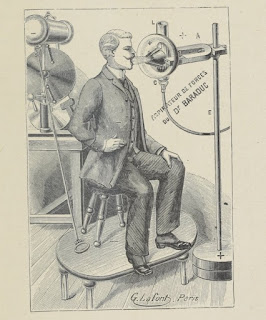
Commentaires
Enregistrer un commentaire